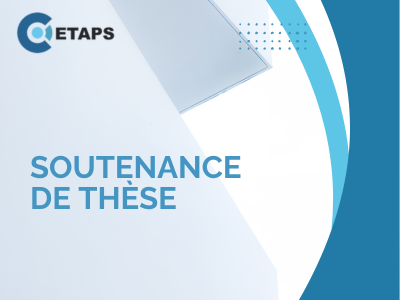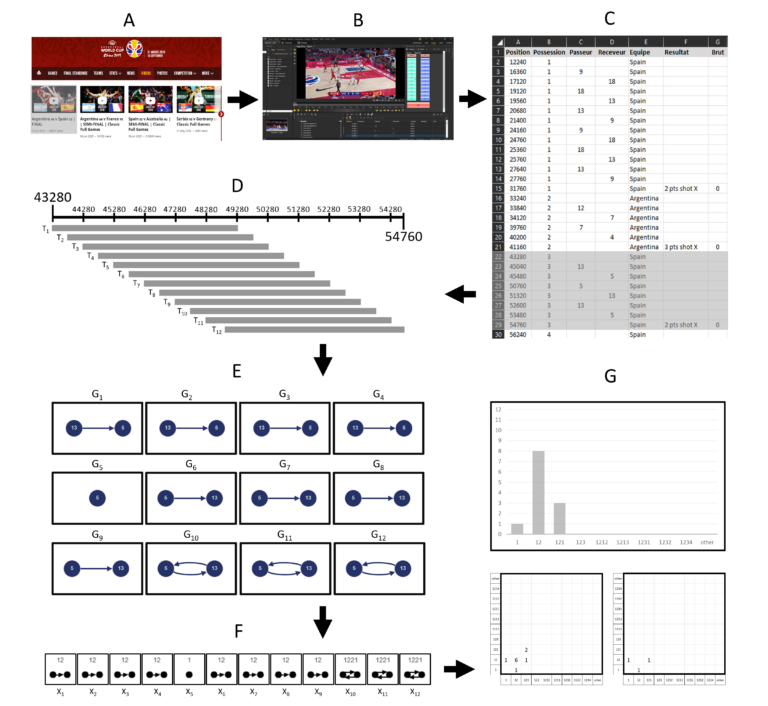Aya El Hajj soutiendra sa thèse de doctorat en STAPS le lundi 3 novembre 2025 à 13h30 intitulée “Stress as an Opportunity for Change in University Students’ Sports Practices During the COVID-19 Era”.
Membres du jury :
Bernard Andrieu : Professeur des universités, Université Paris Cité (Rapporteur)
Sarah Calvin : Professeure des universités, Aix-Marseille Université (Rapporteur)
Fabrice Dosseville : Professeur des universités, Université de Caen Normandie (Examinateur)
Natacha Heutte : Professeure des universités, Université de Rouen Normandie (Examinateur)
Ana Cristina Zimmerman : Professeure des universités, Universidade de São Paulo (Examinateur)
Marie-Pierre Tavolacci : Professeur des universités, CHU Rouen (Examinateur)
Olivier Sirost : Professeur des universités, Université de Rouen Normandie (Directeur de thèse)
Marion Noulhiane : Maitre de conférences HDR, Université Paris Cité (Directrice de thèse)
Tatiana Wahanian Papazian : Maitre de conférences, Université Saint Joseph de Beyrouth (Membre invité)
La soutenance se tiendra dans l’Amphithéâtre Delapille, UFR STAPS, Boulevard André Siegfried, 76130 Mont-Saint-Aignan.
Résumé de la thèse :
Cette thèse examine l’évolution des comportements liés à la santé chez les étudiants universitaires français, en se concentrant sur l’activité physique (AP) et l’engagement sportif dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (Revues : Articles 1 et 2). Les objectifs principaux étaient d’évaluer l’impact des facteurs de stress induits par la pandémie et des politiques sanitaires sur le comportement des étudiants et leur qualité de vie (QDV), en examinant spécifiquement les changements dans les modèles d’AP, les modalités sportives et les motivations parmi la génération Z. Des enquêtes quantitatives et des interviews qualitatives ont été utilisées pour aborder ces objectifs. De plus, le rôle de la pleine conscience (PC) et des pratiques somatiques dans la gestion du stress et la mémoire épisodique a été exploré.
Les contributions expérimentales sont structurées autour de trois axes visant à faire progresser une compréhension interdisciplinaire de la santé des étudiants en intégrant des perspectives de l’épidémiologie, de la sociologie du sport et de la psychologie cognitive. L’Axe 1, Épidémiologie (Etude expérimentale 1), a exploré les comportements liés au mode de vie et la QDV chez les étudiants universitaires. Cette étude a impliqué un questionnaire en ligne administré à 2 189 étudiants universitaires, évaluant l’AP, la pratique sportive, les comportements alimentaires, la PC et la QDV. L’Axe 2, Sociologie du sport (Etude expérimentale 2), a évalué les modèles d’AP et l’engagement sportif parmi les étudiants de la génération Z, en utilisant les données des sections sportives du même questionnaire utilisé dans l’Axe 1. L’Axe 3, Psychologie cognitive, inclut deux articles : (Etude expérimentale 3), qui a étudié les pratiques de pleine conscience et somatiques dans la gestion du stress, combinant approches quantitatives et qualitatives avec 219 étudiants inscrits dans des programmes de bien-être dans deux universités françaises. Des interviews semi-structurées avec des parties prenantes des Services Universitaires des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) ont exploré l’impact des pratiques de pleine conscience pendant et après les restrictions pandémiques. (L’étude expérimentale 4) a examiné l’impact des pratiques de pleine conscience sur la mémoire épisodique, en réalisant des évaluations cognitives avec 34 étudiants en sciences du sport. Les résultats révèlent un changement significatif dans la manière dont les étudiants de la génération Z s’engagent dans l’AP, passant des sports compétitifs et orientés vers la performance à des pratiques plus individualisées, flexibles et orientées vers le bien-être. Cette transformation est attribuée aux facteurs de stress liés à la pandémie, à l’éco-anxiété, à la surcharge numérique et aux défis institutionnels. Les pratiques de PC se sont révélées essentielles pour gérer le stress, améliorer la régulation émotionnelle et la QDV, avec une relation significative avec la fonction cognitive, notamment la mémoire épisodique.
En conclusion, ces contributions interdisciplinaires soulignent la nécessité pour les universités d’adapter leurs programmes de bien-être pour répondre aux besoins évolutifs des étudiants, en favorisant la résilience grâce à des stratégies complètes de promotion de la santé qui abordent à la fois le bien-être physique et mental.